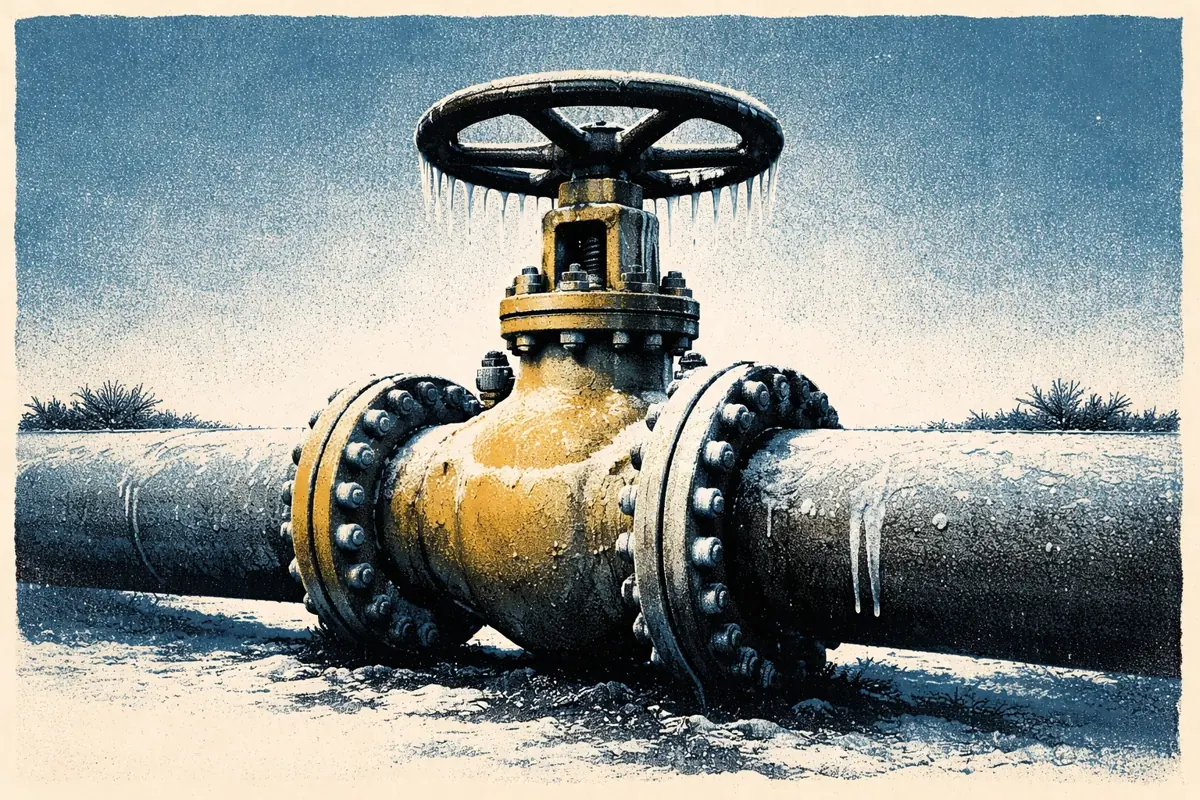Le réseau français évolue : le nucléaire peut-il suivre le rythme ?
Le réseau français évolue : le nucléaire peut-il suivre le rythme ?
Pendant des années, le nucléaire français était considéré comme une source stable et immuable d’électricité de base.
Mais à mesure que les énergies renouvelables se développent et que les prix fluctuent davantage au fil de la journée, la flexibilité nucléaire est devenue un élément clé de l’équilibre électrique quotidien en France. Jusqu’où le parc peut-il encore s’adapter avant que le vieillissement et l’usure n’imposent leurs limites ?
Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article, contactez l’auteur à timothee@modoenergy.com.
Points clés à retenir
- Le parc nucléaire français s’est déjà adapté aux renouvelables. Il module désormais quotidiennement avec le solaire, avec une variation médiane passant à 6 GW en 2025 contre 1,5 GW en 2022.
- Cette flexibilité nucléaire aide, mais n’efface pas la volatilité induite par le solaire. Les prix négatifs et les écarts intrajournaliers augmentent.
- Avec la montée du solaire à midi, des rampes plus profondes mettent l’accent sur la durabilité et les coûts.
- L’allongement de la durée de vie des centrales nucléaires déterminera l’équilibre du système électrique. Leur issue définira le rôle du stockage, alors que les réacteurs de nouvelle génération restent encore éloignés.
1. La flexibilité intrajournalière du nucléaire est devenue la norme en France
En 2025, la flexibilité nucléaire est devenue la norme.
Le nucléaire n’est plus une source de base fixe mais fait désormais partie de l’équilibrage quotidien du système. Avec la montée du solaire, les réacteurs réduisent leur production à midi puis la remontent le soir.
Les variations quotidiennes de la production nucléaire ont fortement augmenté, atteignant en moyenne 6 GW en 2025 contre 1,5 GW en 2022.
Cette flexibilité est saisonnière. Deux tendances marquantes se dégagent :
- L’effet de niveau s’accentue : les réacteurs tournent plus haut en hiver et plus bas en été, et cet écart saisonnier s’est renforcé ces dernières années.
- L’effet de forme s’approfondit : le nucléaire baisse davantage à midi avec la croissance du solaire et se redresse le soir, surtout en été. Les profils hivernaux restent plus plats avec seulement de faibles creux à midi.
À mesure que la capacité solaire et les importations de midi continuent de croître, les besoins de modulation augmentent. Le parc nucléaire a su s’adapter jusqu’à présent. Mais des rampes journalières plus marquées continueront d’éloigner les réacteurs de leur fonctionnement stable habituel, ce qui pourrait peser sur les cycles de maintenance et la longévité technique.
2. La flexibilité nucléaire est dictée par les prix et concentrée sur quelques unités
La flexibilité nucléaire en France est une démarche volontaire. En tant qu’opérateur national en situation de quasi-monopole, EDF pilote le parc nucléaire et ajuste la production en fonction des signaux du marché.
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) estime le coût marginal à court terme lié au combustible du parc nucléaire à 8€/MWh.
En pratique, les réductions de charge interviennent lorsque les prix approchent ou passent en dessous de zéro. Cela suggère que les décisions de modulation d’EDF vont au-delà du coût marginal du combustible, mêlant incitations de marché, stratégie opérationnelle et contraintes techniques.
Cette flexibilité absorbe une partie du surplus solaire mais n’élimine pas les écarts de prix liés au midi. La France a comptabilisé 436 heures à prix négatif en 2025, preuve que ces épisodes deviennent plus fréquents, ce qui maintient l’arbitrage de gros attractif pour les moyens de stockage.
Les prix du marché spot et la production nucléaire évoluent de concert, la génération diminuant à mesure que les prix baissent. Le 10 août, la production est tombée à 41% alors que le prix spot atteignait −50€/MWh.
Cependant, cette flexibilité n’est pas répartie uniformément sur l’ensemble du parc. EDF concentre la modulation sur un groupe de réacteurs, ciblant les ajustements là où ils sont les moins coûteux.
La centrale de Cruas illustre ce potentiel de modulation. Le 10 août, alors que le marché était en fort excédent et que les prix plongeaient à -50€/MWh, la centrale habituellement stable a réduit sa production, démontrant la capacité d’EDF à moduler davantage son parc nucléaire.
Pourquoi certains réacteurs modulent-ils plus que d’autres ?
La flexibilité des réacteurs dépend de plusieurs facteurs :
- Les centrales nucléaires regroupent plusieurs unités. Les opérateurs répartissent la flexibilité entre les réacteurs, concentrant les rampes sur une unité tandis que les autres restent stables.
- En fin de cycle de combustible, la marge de réactivité se réduit, ce qui pousse les opérateurs à limiter la profondeur et la fréquence des rampes, comme le souligne l’Agence de l’énergie nucléaire.
- Localisation sur le réseau et rôle en redispatching : la position géographique d’un réacteur dans le réseau influence la fréquence de ses ajustements, indépendamment des signaux de prix.
- Les conditions opérationnelles et de maintenance propres à chaque unité peuvent limiter la flexibilité. Par exemple, les détections de corrosion sous contrainte en 2022 ont conduit à réduire par précaution la fenêtre de modulation sur certains sites.
La répartition inégale de la flexibilité entre les réacteurs suggère qu’EDF dispose encore de marges pour étendre la modulation à des unités aujourd’hui peu sollicitées. Mais cela impliquerait des rampes soutenues, augmentant l’usure et les coûts, et donc le coût actualisé de l’électricité nucléaire (LCOE).
La question de la durabilité se pose alors. Les études montrent que des rampes plus profondes et fréquentes accentuent le vieillissement des unités, déplaçant l’enjeu du quotidien vers la durée de vie du parc.
3. Le parc nucléaire français approche désormais d’une falaise de capacité
Le parc français s’est constitué rapidement après les chocs pétroliers, avec 56 réacteurs mis en service en deux décennies. Résultat : un système électrique peu carboné et bon marché qui fournissait 78% de la production en 1990 et encore 65% en 2024.
Comme la plupart des capacités ont été ajoutées en peu de temps, de nombreux réacteurs vieillissent en parallèle. D’où le risque d’une « falaise » de capacité à l’approche des retraits.
La feuille de route actuelle de la France repose sur la prolongation du fonctionnement des réacteurs existants. Repousser la durée de vie à cinquante ans, voire au-delà de soixante si possible, est essentiel pour maintenir la capacité alors que les nouveaux réacteurs n’arriveront pas avant plusieurs années.
Chaque prolongation de dix ans fait l’objet d’un examen strict et indépendant par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Des rampes plus profondes et fréquentes accentuent l’usure mécanique, ce qui peut peser sur ces examens et, in fine, remettre en cause les prolongations.
Dans ce contexte, la capacité future dépend de deux variables : jusqu’où les prolongations peuvent aller en toute sécurité sur le parc existant, et le rythme du programme EPR2 (nouveaux réacteurs pressurisés européens) du gouvernement.
Perspectives
Le mix électrique français entre dans une phase charnière. Entre prolongation de la durée de vie des centrales et attente des nouveaux réacteurs, l’équilibre entre stabilité nucléaire et essor des renouvelables va marquer la décennie à venir.
Si le parc tient, le nucléaire stabilisera les prix et les batteries se concentreront sur la réserve et l’optimisation du réseau. Si le vieillissement et la flexibilité accrue raccourcissent la durée de vie des réacteurs, le stockage deviendra indispensable pour combler l’écart et soutenir la production à mesure que l’électrification s’accélère.