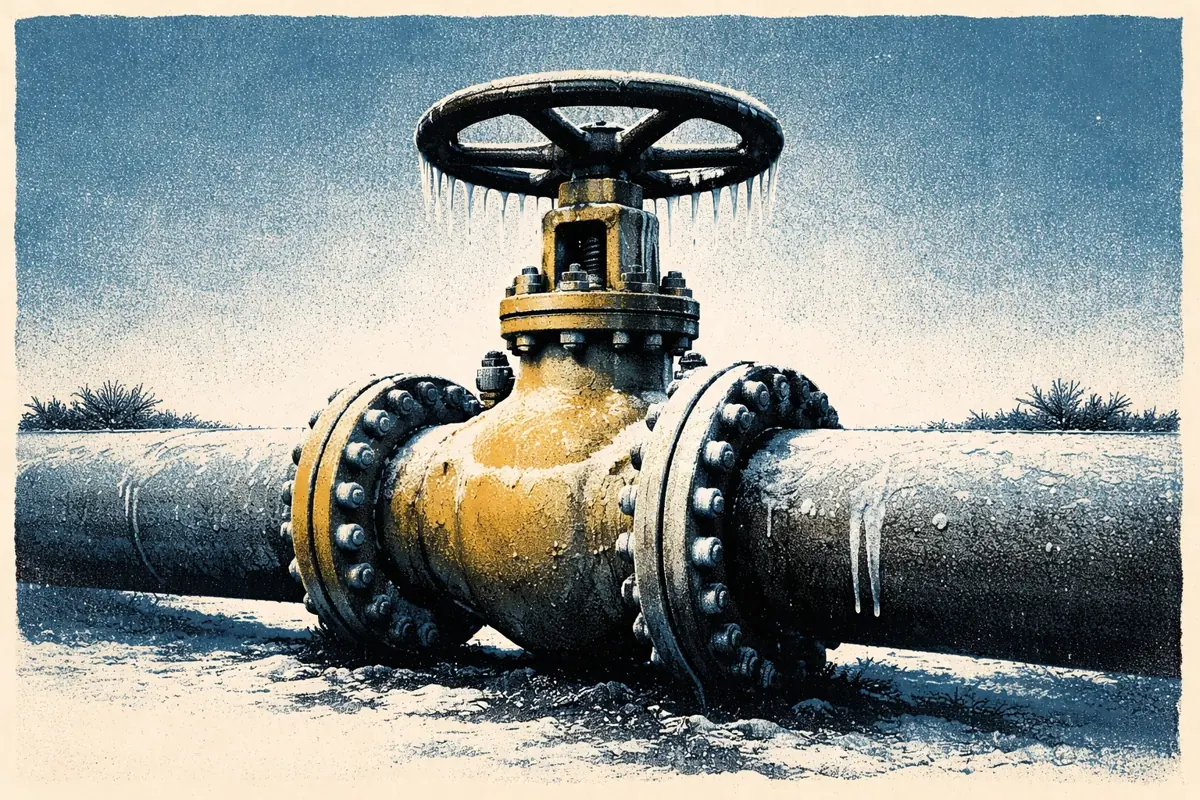Le stockage, la pièce manquante du système électrique français ?
Le stockage, la pièce manquante du système électrique français ?
Le système électrique français est à un tournant. Longtemps dominé par le nucléaire et l’hydroélectricité, il fait désormais face au vieillissement des installations et à une croissance rapide du solaire qui bouleverse les prix et met la flexibilité du réseau à l’épreuve. À mesure que le marché évolue, le stockage d’énergie par batteries pourrait-il devenir l’élément clé pour garantir un système bas-carbone et fiable ?
Si vous avez des questions sur le contenu de cet article, contactez l’auteur à timothee@modoenergy.com.
Points clés
- Le nucléaire et l’hydroélectricité assurent un système bas-carbone et stable. Cependant, le parc nucléaire vieillit, l’hydroélectricité a atteint sa capacité maximale et les deux entrent dans une phase plus incertaine.
- La croissance rapide des énergies renouvelables modifie le profil intrajournalier, contribuant à 436 heures de prix négatifs en 2025. Plus de flexibilité est nécessaire pour déplacer l’électricité de midi vers le soir.
- Le stockage par batteries aujourd’hui : plus de 1 GW installés, principalement pour des services auxiliaires de courte durée : les prix se maintiennent mais indiquent une maturation du marché.
- Le stockage demain : la prochaine vague de batteries vise à capter l’écart croissant entre les prix du marché au jour le jour et en intrajournalier.
1. Le réseau français passe du nucléaire aux renouvelables, ouvrant la voie au stockage par batteries.
Le nucléaire et l’hydroélectricité restent la colonne vertébrale du système
La France se distingue en Europe par une base solide et bas-carbone, construite sur le nucléaire et l’hydroélectricité.
- Nucléaire : En 2024, la production a atteint 362 TWh, soit environ 65 % de l’approvisionnement, pour 63 GW de capacité.
- L’hydroélectricité ajoute 75 TWh grâce à 25 GW d’installations.
Cette situation contraste avec des pays voisins comme l’Allemagne, où le mix combine renouvelables, gaz et charbon.
Mais le vieillissement des installations et l’essor du solaire mettent le système à l’épreuve
Le nucléaire et l’hydroélectricité restent centraux dans le système français, mais tous deux entrent dans une phase plus incertaine.
Le parc nucléaire français vieillit :
- 52 des 57 réacteurs ont plus de 30 ans
- 23 réacteurs ont plus de 40 ans
La production hydroélectrique est restée globalement stable, avec une capacité totale quasi inchangée, en hausse de seulement 264 MW (+1,04 %) entre 2016 et 2025. De plus, avec le changement climatique, la variabilité des précipitations et les périodes de sécheresse prolongées accentueront la volatilité saisonnière.
De nouvelles capacités renouvelables sont ajoutées pour soutenir et compléter ce pilier vieillissant.
La croissance de l’éolien a ralenti ces dernières années, freinée par des résistances politiques et des coûts plus élevés, mais le solaire a connu un essor. En 2024, la capacité solaire a dépassé 24 GW pour une production de 25 TWh.
2. Les évolutions actuelles créent de la valeur pour le stockage par batteries
Le solaire transforme la production de midi en contrainte
Les appels d’offres soutenus par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) ont permis d’augmenter la capacité solaire installée de plus de 5 GW en 2024.
Plus de capacité signifie des excédents plus fréquents, ce qui impacte la courbe des prix. Les prix chutent au pic solaire, puis remontent le soir lorsque la demande augmente et que le solaire décline.
En 2025, la baisse des prix à midi atteint 45 % du prix horaire moyen, contre 92 % en 2020.
La baisse des prix à midi se traduit par une forte augmentation des heures à prix négatifs. En 2024, on a compté 359 heures de prix négatifs, soit plus du double de 2023. Cette tendance se poursuit en 2025, symptôme clair d’un manque de flexibilité.
Avec la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) visant 44 à 52 GW de solaire d’ici 2035 (contre 24 GW en 2024), les excédents de midi continueront probablement d’augmenter. Le déficit de flexibilité va s’accentuer à moins que le stockage et la flexibilité de la demande ne se développent rapidement.
La position centrale de la France complique l’évacuation du surplus solaire
La France est au cœur du réseau européen avec de puissantes interconnexions sur toutes ses frontières. Ces liaisons permettent d’exporter ou d’importer d’importants volumes d’électricité selon les conditions du marché.
Le solde commercial est fortement exportateur. Chaque année, la France exporte plus d’électricité qu’elle n’en importe, grâce à une base de production stable qui s’écoule bien à l’international.
Les exportations stables de nucléaire et d’hydroélectricité sont absorbées par l’étranger, surtout lorsque les renouvelables y sont faibles. Cela permet aux pays importateurs d’éviter de démarrer des centrales thermiques fortement émettrices.
Mais autour de midi, de nombreux voisins, notamment l’Allemagne, disposent également d’un surplus solaire. L’excédent doit alors être absorbé en France, ce qui fait basculer les prix en négatif.
De nouvelles liaisons comme la Celtic Link vers l’Irlande (700 MW, prévue pour 2028) offriront un exutoire vers un système moins dépendant du solaire lorsque le continent sera saturé à midi.
Elles aideront à la marge, mais le stockage sera indispensable pour déplacer l’énergie vers le soir et éviter de gaspiller une électricité propre et peu coûteuse.
3. Des signaux aux profits : comment le stockage par batteries peut valoriser la transition
La première vague de batteries est déjà opérationnelle en France
La France a déjà franchi le cap du gigawatt de systèmes de stockage par batteries (BESS) opérationnels. La capacité installée progresse régulièrement depuis 2020.
Jusqu’ici, le stockage d’énergie par batteries en France a joué un rôle ciblé mais essentiel. La plupart des systèmes en service sont de courte durée et optimisés pour les services auxiliaires, principalement la réserve de réglage de fréquence (FCR) et, plus récemment, la réserve automatique de restauration de fréquence (aFRR).
De nouveaux projets sont également développés avec des durées de stockage plus longues, passant de moins d’une heure en moyenne à près de deux heures d’ici 2025.
aFRR tire aujourd’hui les revenus, mais l’équilibre va évoluer
Le marché de la capacité aFRR a ouvert en 2024 et a remplacé le marché FCR, plus limité, comme principale source de revenus pour les batteries en France.
La divergence croissante entre les offres Up et Down, liée à des stratégies d’enchères plus sophistiquées, montre que le marché se structure et reflète mieux les coûts d’opportunité.
Les prix de la capacité aFRR restent élevés pour l’instant, mais à mesure que de nouvelles batteries qualifiées arrivent sur le marché, on s’attend à une baisse des prix moyens à moyen terme.
Prochaine étape : arbitrage day-ahead et intrajournalier
À mesure que les services auxiliaires se saturent, les signaux du marché de gros se renforcent. Les batteries peuvent de plus en plus acheter lorsque le solaire inonde le système et revendre lors des pics de demande en soirée.
Les écarts Top-Bottom se sont encore élargis en 2025. Par exemple, l’écart TB2 a augmenté de 27 % par rapport à 2024.
Ces évolutions créent des opportunités d’arbitrage plus régulières sur les marchés day-ahead et intrajournaliers. Avec des durées proches de deux heures, les batteries peuvent de mieux en mieux valoriser ces écarts.
La prochaine vague du stockage par batteries est là, ouvrant de nouvelles opportunités pour les investisseurs
La première vague a surtout tiré sa valeur de la FCR et de l’aFRR. La suivante s’oriente vers l’arbitrage sur les marchés de gros, complété par des services empilés.
Pour les développeurs et investisseurs, la voie équilibrée consiste à valoriser les services auxiliaires aujourd’hui tout en se préparant à capter l’élargissement des écarts sur les marchés day-ahead et intrajournaliers.